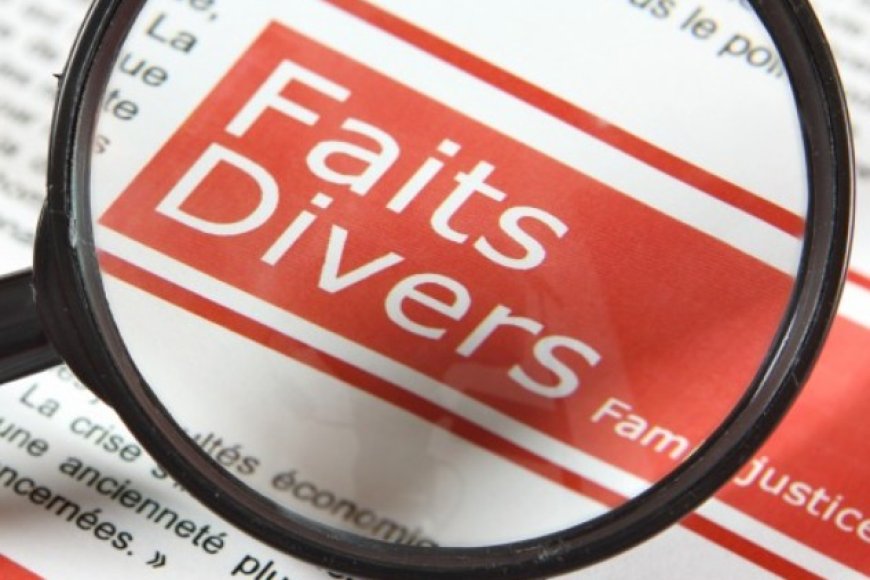De gauche à droite : M. Assime, Directeur Coordination et Veille, Chef de Département Contrôle Technique, Morocco Foodex; M. Paul-Henri Presset, Chef de la Section Commerce à la Délégation de l’UE au Maroc; Mme Alice O’Donovan, Secrétaire Générale – CELCAA; Mr Karl Falkenberg, Ex Cadre dirigeant à la Commission Européenne, Consultant International; M. Najib Azzouzi, Secrétaire Général de Morocco Foodex; Mme Anna Boulova, DG SACAR Group, SG FRUCOM, ex Directrice de la Représentation de CONXEMAR-Europe, membre fondateur du MAC; Mme Ingrid Morvan, Experte au COLEAD, AGRINFO; M. Amine Chafai, Délégué Principal de Morocco Foodex à Bruxelles
À l’heure où l’Union européenne durcit ses exigences environnementales, sociales et sanitaires, les exportateurs marocains doivent impérativement adapter leurs pratiques pour rester dans la compétition. Entre traçabilité renforcée, nouvelles obligations réglementaires et attentes sociétales croissantes, l’accès au marché européen devient encoreplus complexe, mais reste incontournable.
C’est dans ce contexte de transition que Morocco Foodex a organisé, les 24 et 25 juin à Marrakech, un workshop international animé par M. Amine Chafai, délégué principal de Morocco Foodex à Bruxelles. Pendant deux jours, les opérateurs agroalimentaires et halieutiques ont pu décrypter les nouvelles règles du jeu, explorer les leviers de conformité et s’interroger sur la soutenabilité des modèles de production actuels.
Parmi les annonces structurantes, le lancement en phase de test du standard Morocco Sustain Food®, premier référentiel étatique marocain dédié à l’export durable. Objectif : valoriser les engagements RSE des entreprises, simplifier les audits en capitalisant sur les certifications déjà obtenues, et offrir une réponse souveraine aux attentes européennes en matière de durabilité.
Plus qu’un simple événement technique, ce workshop a posé les bases d’une réflexion stratégique : comment renforcer la compétitivité marocaine tout en assumant les responsabilités environnementales et sociales qui s’imposent désormais aux acteurs du commerce mondial ?
« Ce workshop s’inscrit dans une nouvelle dynamique, portée par Morocco Foodex, visant à sensibiliser les opérateurs marocains aux exigences croissantes d’accès au marché de l’Union européenne. Véritable « warning event », ce rendez-vous marque la première déclinaison sectorielle du grand événement organisé les 20 et 21 septembre 2024 à Agadir », a souligné M. Amine Chafai.
654 Mrd DH d’échanges UE-Maroc
Paul-Henri Presset, chef de la Section Commerce à la Délégation de l’Union européenne au Maroc, a souligné l’importance stratégique d’un partenariat « en pleine maturité », faisant référence à l’accord d’association Union européenne-Maroc signé en 1996 et entré en vigueur en 2000. Ce partenariat couvre un vaste champ de coopération, allant du commerce à l’agriculture, en passant par la durabilité, l’investissement et la convergence réglementaire. Depuis son entrée en vigueur, il a permis de renforcer des liens devenus essentiels pour les deux parties.
Paul-Henri Presset, chef de la Section Commerce à la Délégation de l’Union européenne au Maroc
« Cette année, nous fêtons les 25 ans de l’accord d’association Union européenne-Maroc », a-t-il rappelé. En 2024, le commerce bilatéral a atteint 654 milliards de dirhams (plus de 60 milliards d’euros), un chiffre multiplié par cinq depuis la mise en œuvre de l’accord. L’Union européenne reste le premier partenaire économique du Royaume : elle fournit près de 50 % des importations marocaines et absorbe deux tiers des exportations. En matière d’investissements, plus de la moitié des IDE enregistrés proviennent également de l’UE, faisant du Maroc son principal partenaire commercial en Afrique.
L’évolution des équilibres commerciaux est tout aussi significative : en 2024, les exportations marocaines vers l’UE ont couvert 79 % des importations européennes, contre 77 % en 2023. Un ratio bien supérieur à celui des échanges avec la Chine (4 %) ou les États-Unis (19 %).
Depuis l’extension de l’accord aux produits agricoles et halieutiques en 2012, les échanges agroalimentaires ont triplé, atteignant 7 milliards d’euros en 2024. Le Maroc est devenu le premier fournisseur de légumes de l’UE et le deuxième exportateur mondial de produits de la mer, avec près de 2 milliards d’euros d’échanges.
Face aux critiques formulées à l’encontre de la réglementation européenne, Paul-Henri Presset a tenu à rappeler leur raison d’être : « Ce sont des réglementations prévisibles, légitimes, et annoncées longtemps à l’avance. Elles répondent à des défis partagés comme la sécurité alimentaire, la santé du consommateur et la lutte contre le changement climatique. »
Et de rajouter : « Ces réglementations ne sont en aucun cas des barrières commerciales, mais des solutions pour répondre à des défis communs », a-t-il ajouté. Il a également présenté les mécanismes d’accompagnement des exportateurs, notamment le Partenariat Vert Maroc-UE, qui vise à favoriser une transition durable et équilibrée des échanges agricoles.
Exporter dans un monde qui change
« Le Maroc peut tirer parti d’opportunités dans les secteurs agroalimentaire et halieutique en répondant de manière proactive aux attentes sociales et environnementales des marchés européens. ». C’est par ce message que Karl Falkenberg, ancien cadre dirigeant de la Commission européenne, s’est adressé aux opérateurs marocains réunis à Marrakech.
À l’heure où les repères géopolitiques et économiques se redessinent, exporter dans un monde en mutation implique de repenser les rapports de force commerciaux et les équilibres environnementaux. M. Falkenberg a ainsi défendu une vision stratégique du commerce international fondée sur l’équité, la coopération et la durabilité.
Il a rappelé le rôle central de l’Union européenne dans les échanges mondiaux. Si les performances des États membres apparaissent séparément dans les statistiques internationales, leur addition place l’UE devant la Chine et les États-Unis. Le commerce, selon lui, reste un levier puissant de développement. Entre 1995 et 2022, les pays à revenus faibles ou intermédiaires intégrés aux circuits mondiaux ont vu leurs revenus progresser significativement. La Chine constitue l’exemple emblématique :
« Ce succès de sortir quelque 600 millions de Chinois de la pauvreté est directement lié à l’accession de la Chine à l’OMC en 2002 », a-t-il souligné.
S’agissant du Maroc, il a salué les efforts que le pays a déployés pour rééquilibrer sa balance commerciale avec l’Union européenne : « C’est un véritable défi pour un pays comme le Maroc d’équilibrer ses échanges avec un acteur aussi complet que l’Union européenne, mais il s’y attache avec succès », a-t-il noté.
La répartition équitable des richesses issues du commerce international a également été au cœur de son intervention. Si les inégalités diminuent globalement, les bénéfices restent inégalement répartis. « Nous sommes encore loin d’un résultat véritablement satisfaisant », a reconnu M. Falkenberg.
Enfin, M. Karl Falkenberg a alerté sur l’urgence climatique, rappelant que les effets des émissions de CO₂ se feront sentir pendant des décennies, même en cas d’arrêt immédiat. « Nous ne pouvons agir qu’ensemble », a-t-il insisté, en soulignant la vulnérabilité particulière du Maroc face aux sécheresses prolongées et aux épisodes de pluies extrêmes.
+120 M€ d’export marocain
Face aux bouleversements réglementaires en Europe, Alice O’Donovan, secrétaire générale du CELCAA (Comité européen de liaison du commerce agroalimentaire), appelle à inscrire les relations agroalimentaires UE-Maroc dans une dynamique de long terme, fondée sur la résilience, l’équité et la coopération.
Depuis 25 ans, le CELCAA –– défend l’idée que le commerce doit être reconnu comme un pilier essentiel des systèmes alimentaires durables. Représentant les intérêts de nombreuses filières (vins, viande, œufs, produits laitiers, huiles végétales, plantes aromatiques, etc.), il participe activement aux groupes de dialogue civil de la Commission européenne.
« La forte dépendance de l’Europe aux importations de produits végétaux continue d’ouvrir des perspectives pour les producteurs marocains », a souligné Alice O’Donovan. En 2024, les exportations marocaines de produits végétaux vers l’UE ont connu une progression marquée. Parmi les principales catégories figurent les conserves végétales (120 M€), les huiles (notamment l’huile d’olive, 35,2 M€), les plantes à parfumer (33,8 M€), ou encore le thé (6,7 M€).
Le contexte européen reste néanmoins marqué par de fortes turbulences. Depuis la mise en œuvre du Pacte vert et de la stratégie “De la ferme à la table”, les agriculteurs européens dénoncent une surcharge réglementaire. Ces tensions ont conduit à un vaste Dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture, dont les conclusions publiées en février 2025 dessinent une nouvelle vision à l’horizon 2040 : renforcer l’attractivité du secteur, assurer un revenu équitable et garantir la sécurité alimentaire.
Mais les clauses miroirs , visant à aligner les normes de production des produits importés sur celles de l’UE , posent question. Pour le CELCAA, il est crucial de ne pas négliger la diversité des conditions de production dans le monde. D’autres propositions sont également sur la table : application plus stricte contre les pratiques commerciales déloyales, soutien renforcé aux jeunes agriculteurs, stratégie de renouvellement générationnel et accès accéléré aux biopesticides.
« Nous soutenons la diplomatie économique agroalimentaire et appelons à poursuivre les discussions sur les standards dans les forums multilatéraux comme l’OMC », a précisé Mme Alice O’Donovan. Dans un contexte de tensions climatiques, économiques et sociales, le CELCAA plaide pour une approche fondée sur le dialogue, la transparence et la coopération durable entre l’Europe et ses partenaires, dont le Maroc.
La labelisation et la certification des produits halieutiques : un enjeu stratégique
M. Lahsen Ababouch, ancien directeur du Département des pêches et de l’aquaculture à la FAO
Alors que la pression sur les ressources marines s’intensifie, M. Lahsen Ababouch, ancien directeur du Département des pêches et de l’aquaculture à la FAO, a dressé un état des lieux sans détour des mutations du secteur halieutique mondial, marqué par la stagnation des captures et l’essor rapide de l’aquaculture. Depuis les années 1990, les captures stagnent tandis que l’aquaculture s’impose comme la principale source de croissance : « Aujourd’hui, 57 % du poisson consommé dans le monde provient de l’aquaculture, contre seulement 7 % à la fin des années 1980 », a-t-il précisé.
La consommation mondiale augmente, tirée par les classes moyennes et les préoccupations nutritionnelles. Au Maroc, elle a doublé en 12 ans, passant de 8 à plus de 16 kg par habitant. Mais cette croissance s’accompagne de défis majeurs : surexploitation, pêche illégale, pollution, disparition des mangroves et pression sur les petits pélagiques utilisés comme aliments dans les élevages.
Face à cela, les régulations se multiplient : quotas, normes sanitaires, gestion des ressources migratoires. Les ONG jouent un rôle croissant avec la montée des certifications. M. Lahsen Ababouch estime que « l’évaluation publique des performances environnementales demeure l’un des outils les plus efficaces ».
Il alerte cependant sur la prolifération des labels, leur coût élevé, et le manque de reconnaissance des pêcheries en transition. Il appelle à relancer un label national marocain crédible, en s’inspirant des Fisheries Improvement Programs (FIP) par exemple : « Le marché reconnaît désormais que des pêcheries comme celle du Sahara marocain, engagées depuis 2010, méritent considération et confiance. »
UE : 91 % des sardines importées
Mme Anna Boulova, DG SACAR Group, SG FRUCOM, ex Directrice de la Représentation de CONXEMAR-Europe, membre fondateur du MAC
Mme Anna Boulova, directrice générale de SACAR Group et secrétaire générale de FRUCOM, a souligné le rôle stratégique du Maroc dans l’approvisionnement de l’Union européenne en produits de la mer.
« Le Maroc est extrêmement important pour nous », a-t-elle martelé, rappelant que 70 % des produits de la pêche consommés dans l’UE sont importés, un chiffre qui atteint même 91 % pour les sardines.
Dans ce contexte de dépendance accrue aux importations, l’Union européenne renforcera ses exigences en matière de traçabilité. À compter du 10 janvier 2026, le système CATCH (Catch Certification), une plateforme européenne de certification électronique des captures visant à lutter contre la pêche illégale, deviendra obligatoire pour tous les importateurs européens. Bien que son usage reste facultatif pour les exportateurs marocains, il sera fortement recommandé, car de plus en plus exigé par les clients européens.
Pour anticiper ces évolutions, FRUCOM encourage les opérateurs à suivre les projets réglementaires en cours, notamment via ses groupes de travail et le portail AGRINFO. L’organisation collabore étroitement avec la Commission européenne, notamment à travers les conseils consultatifs MAC (Marchés) et LDAC (Pêche lointaine).
« Nous avons les standards les plus élevés au monde et voulons éviter une concurrence déloyale », a-t-elle affirmé.
Dans ce contexte, les actions de plaidoyer se multiplient. Le lobby importateur renforce sa coordination avec la représentation de Morocco Foodex auprès des institutions européennes, afin de relayer les doléances du secteur exportateur marocain et de contribuer à l’allègement des barrières non tarifaires freinant les échanges.
Métaux lourds, MOAH, additifs, etc. : ce qui attend les exportateurs marocains dès 2025
Mme Ingrid Morvan, Experte au COLEAD, AGRINFO
Mme Ingrid Morvan, représentante du COLEAD, a mis en garde contre le durcissement des exigences européennes. « Chaque année, près de 180 nouvelles règles agroalimentaires sont introduites dans l’Union », a-t-elle rappelé.
Grâce à AGRINFO, les opérateurs peuvent suivre les seuils révisés, règlements, consultations publiques et notifications RASFF. En 2024, les exportations marocaines de produits transformés ont atteint 2 millions de tonnes, mais 15 alertes RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ont été signalées au premier semestre 2025 (résidus de pesticides, additifs non autorisés).
Les sujets sensibles incluent les limites pour le nickel, l’arsenic, les MOAH/MOSH, la Listeria, les antimicrobiens et les plastiques à usage unique. « Les secteurs comme les épices, les produits gras ou le cacao devront cartographier leur chaîne d’approvisionnement », a-t-elle alerté.
Produits composés : vigilance accrue pour une niche d’innovation à fort potentiel pour l’origine Maroc
Le nouveau règlement européen 2022/2292 impose des conditions renforcées pour l’exportation de produits composés, ceux contenant à la fois un ingrédient d’origine animale transformé (lait, œufs, viande cuite…) et un ingrédient végétal.
La principale nouveauté réside dans le critère de température de conservation : si le produit est réfrigéré, ou contient de la viande ou du colostrum, les exigences sanitaires sont maximales. « L’ancienne logique fondée sur le pourcentage d’ingrédients d’origine animale n’avait pas de base scientifique solide », a rappelé Julie Poirot (DG Santé). Ce critère a été remplacé par l’obligation ou non de maintenir le produit au froid.
Le Maroc peut exporter des produits composés à température ambiante, comme des biscuits au lait ou aux œufs, si ces ingrédients proviennent d’un pays agréé par l’UE ou de l’UE elle-même. En revanche, il ne peut pas exporter des produits composés réfrigérés ou contenant de la viande ou du colostrum, sauf autorisation spécifique. « Le Maroc est bien positionné pour les produits non réfrigérés, mais doit redoubler de vigilance sur l’origine et le traitement des ingrédients animaux », ont prévenu les experts européens.
Les documents exigés varient selon le produit : une déclaration suffit pour les produits ambiants sans viande, mais un certificat sanitaire est requis dès qu’il y a température contrôlée ou ingrédients sensibles. « Même si le biscuit n’exige qu’une déclaration, le beurre qu’il contient doit répondre à toutes les règles imposées aux produits laitiers », a précisé Paolo Caricato.
Le respect de ces règles est désormais indispensable pour accéder au marché européen sans blocage.
Épices : alerte sur les seuils de contaminants
Les épices sont majoritairement destinées à l’industrie agroalimentaire (70 à 80 %), mais la montée des exigences réglementaires impose aux fournisseurs d’assurer l’authenticité, la conformité et la durabilité.
« La qualité, la conformité et la durabilité sont devenues des prérequis. Le Maroc, déjà bien positionné, peut renforcer ses parts de marché à condition de répondre à ces nouvelles exigences », a souligné Paolo Patruno, Expert au programme BTSF (Better Training for Safer Food), rappelant que deux entreprises marocaines sont déjà membres de l’ESA (European Spice Association).
Les défis sont nombreux : fraudes sur l’origan (près d’un tiers des échantillons falsifiés), présence récurrente de substances interdites comme l’oxyde d’éthylène ou le duochloroéthylène, et limites de résidus de pesticides de plus en plus strictes.
« Nous avons toujours des alertes sur l’oxyde d’éthylène, mais aussi sur des composés comme le duochloroéthanol, régulièrement détectés dans des lots d’origan et de cumin importés », a-t-il alerté.
En parallèle, la filière entend faire de la durabilité un levier concurrentiel. Un code de conduite, un comité durabilité et un accord avec la Sustainable Spice Initiative sont prévus dès 2025.
« La durabilité devient un avantage concurrentiel au même titre que la conformité technique », a affirmé M. Patruno, en appelant à intégrer dès l’amont les pratiques sociales, la traçabilité et la réduction de l’empreinte carbone.
Le message est clair : pour continuer à exporter vers l’UE, les opérateurs marocains doivent anticiper les contrôles et structurer leur offre autour de la transparence et de la responsabilité.
Morocco Sustain Food® : un nouveau standard étatique pour des exportations durables
Fruit d’une collaboration entre Morocco Foodex, la FAO, la BERD et l’Union européenne, le standard Morocco Sustain Food® trace une nouvelle voie pour les exportations agroalimentaires marocaines. Il repose sur une approche intégrée dite 360°, articulée autour de quatre piliers fondamentaux : la qualité des produits, la gouvernance, le respect de l’environnement et la responsabilité sociale.
Selon Mustapha Khibabi, Chef du Département Développement et Facilitation à Morocco Foodex, « le standard Morocco Sustain Food® est conçu pour être évolutif, inclusif et flexible ».
Trois niveaux de maturité sont proposés aux entreprises pour structurer leur progression : Le premier niveau, dit d’engagement, marque l’adhésion volontaire au référentiel et la mise en place d’une gouvernance initiale. Le deuxième niveau, dit d’implémentation, implique l’application concrète de bonnes pratiques sur les différents volets couverts par le standard. Le troisième niveau, dit d’excellence, atteste d’un haut niveau de performance, vérifié par un audit indépendant.
Le dispositif comprend la formation de 30 auditeurs selon les standards internationaux (FAO, OIT, ISO), des audits gratuits pendant trois ans pour les entreprises pilotes, un accès facilité aux salons internationaux, ainsi qu’un accompagnement opérationnel via le programme Cap Export.
Pour tester son efficacité, une caravane nationale a sillonné six grandes villes du Royaume, réunissant plus de 600 participants à travers divers workshops. En parallèle, 20 entreprises leaders ont été visitées afin d’ajuster le référentiel aux réalités opérationnelles.
Le standard est actuellement en phase pilote. Son lancement officiel est prévu dans les mois à venir, avec l’ambition de devenir un outil structurant et reconnu de compétitivité durable pour les exportateurs marocains.
Ce projet d’écolabel, le Morocco Sustain Food®, a été salué par les intervenants européens présents, qui y voient une avancée majeure vers une compétitivité durable conforme aux exigences du marché communautaire. Avant même le déploiement de la stratégie de communication autour de cet écolabel auprès des décideurs européens, plusieurs d’entre eux ont souligné la nécessité d’aligner le référentiel sur les standards de l’Union européenne, notamment le règlement relatif au greenwashing. Ils ont également insisté sur l’importance d’impliquer, dès la phase d’ingénierie, les ONG de défense des droits des consommateurs, afin de renforcer la crédibilité et l’adhésion internationale au standard.
The post L’UE ouvre ses portes… à qui coche toutes les cases first appeared on FOOD Magazine.